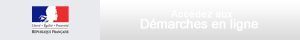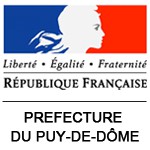Sous Louis XV sont entrepris de grands travaux de modernisation du réseau routier. L’intendant Trudaine poursuit donc à partir de 1730 la réfection complète du « Grand chemin d’Auvergne au Languedoc » qui relie Clermont au Puy et qui passe à Veyre. Si les ouvrages d’art ou murs de soutènement sont adjugés à des entreprises, les travaux de terrassement et d’empierrement sont effectués par les habitants, réquisitionnés, des paroisses limitrophes : c’est la « corvée royale ». La paroisse de Monton, qui englobe Veyre et Soulasse, est mise à contribution.
Dans chaque paroisse un syndic pour les chemins est chargé d’établir un rôle (une liste) des hommes qui participeront à la corvée, et un rôle de ceux qui possèdent des attelages. Les premiers, les « manœuvres », assurent la « corvée à bras ». Ils doivent être munis d’une pelle et d’une pioche. Les seconds, les « laboureurs », font la « corvée à bœufs ». Ils transportent la terre ou les pierres dans leurs tombereaux. La corvée a lieu par périodes de trois jours, en-dehors des travaux de fenaison, moisson, vendange.
Nous trouvons ainsi aux Archives départementales la liste nominative des 41 hommes de la paroisse de Monton qui ont été convoqués par le syndic Antoine Guittard et ont travaillé à « l’attellier de Vayre à Coude » les 3, 4 et 6 juillet 1733, chacun payé 2 sols par jour, le sous-inspecteur qui les dirige recevant dix fois plus. (Illustration).
Il y avait à cette époque à Monton 306 corvéables, âgés de 16 à 69 ans, et 51 paires de bœufs. Les hommes allaient à la corvée à tour de rôle ; chacun devait un total de douze jours par an. En principe ils ne pouvaient pas s’y soustraire, les récalcitrants étant menacés de lourdes amendes ou de l’obligation de loger un cavalier de la Maréchaussée à leurs frais.
Comme la route n’était qu’un large chemin empierré, il s’y creusait rapidement des ornières et des nids-de-poule. Elle demandait un entretien constant, réparti entre les paroisses riveraines. Monton était responsable de 1234 toises (2,4 km). Vers la fin du siècle, les réticences à la corvée se manifestent ouvertement : à l’automne 1783, les corvéables de Monton sont « défaillants » ; la communauté doit payer une entreprise qui fera les travaux à leur place. En 1785, les habitants décident de confier pour neuf ans l’entretien des chemins à une entreprise choisie par adjudication. Mais, deux ans plus tard, la corvée royale est abolie et remplacée par un impôt…
Jacques Plyer (Sites et Patrimoines)