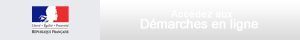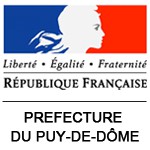En 1808, le maire Marnat Courbaire est convaincu, comme ses concitoyens, qu’il n’est pas de sacrifices que l’on ne doive faire pour améliorer la fourniture en eau potable de la commune. Or, cette année là, un clermontois, Monsieur Tabaret, « connu par quelque succès dans l’art hydraulique, après avoir parcouru et examiné les différentes positions qui dominent les habitations, se dit en mesure de fournir une quantité d’eau plus que suffisante pour l’usage des habitants », soit 28 litres d’eau au moins par minute.
Son projet et ses offres sont accueillis avec enthousiasme, et le maire signe avec lui une convention le 10 juillet 1808.
On creusera des puisards au-dessous du puy de Monton, pour y découvrir des sources et conduire l’eau par des « galeries souterraines » jusqu’à l’emplacement où sera établie une fontaine.
La municipalité fournira huit ouvriers par jour pour le creusement des puisards et douze pour l’ouverture des galeries.
Le devis prévoit une « galerie souterraine de 250 mètres de longueur sur deux mètres de hauteur et un de largeur, à 10, 15 et 20 mètres de profondeur suivant la pente » ; un canal « à pierre sèche » de 200 mètres « pour recevoir les eaux et les conduire dans un regard en pierre » ; 50 mètres de tuyaux en pierre de Volvic pour conduire l’eau de ce regard à un autre ; la construction de « trois tours en bois pour l’extraction des terres » ; 65 douzaines de planches et 100 sablières pour étayer les galeries ; 25 kilogrammes de cordes ; « deux quintaux d’huile pour éclairer les ouvriers dans les souterrains ».
L’année suivante, le maire déplore amèrement les difficultés rencontrées à creuser « dans un tuffe (sic) extrêmement solide » et les « dépenses énormes » que nécessite la « grande entreprise ». Il en redoute un succès relatif.
Pourtant la nouvelle fontaine, qu’on ne tardera pas à nommer « Tabarelle », remplit d’abord à peu près son office Elle est progressivement aménagée (1811), protégée par une voûte (après 1822) et son accès facilité par 8 marches de 3 mètres de long chacune, en pierre de Volvic (1899). Malheureusement, avec le temps, des éboulements dans la galerie en font baisser le débit. Un rapport de 1885 indique les débits des fontaines à la disposition des 1600 habitants du bourg : par minute, la Tabarelle donne 5,26 litres (la Bonne fontaine : 2,72 l, la fontaine du Bartiat : 2,14 l). En 1897-1898 on se lance dans des travaux qui en augmentent le débit... d’un demi litre ! Qui garde encore à l’esprit pareille pénurie ?
En 1913-1914 elle reste la « seule fontaine vraiment propre à la consommation », les fontaines du Bartiat et la Bonne fontaine étant alors « plus particulièrement utilisées pour l’alimentation du bétail et pour le blanchissage ».
Elle disparaît quand on réaménage la rue qui traverse le bourg. On n’en distingue plus aujourd’hui que l’arrondi de la voûte, pris dans un mur de soutènement. Aucune photographie ancienne, à notre connaissance, ne la représente.
Geneviève Plyer (Sites et Patrimoines)